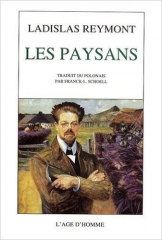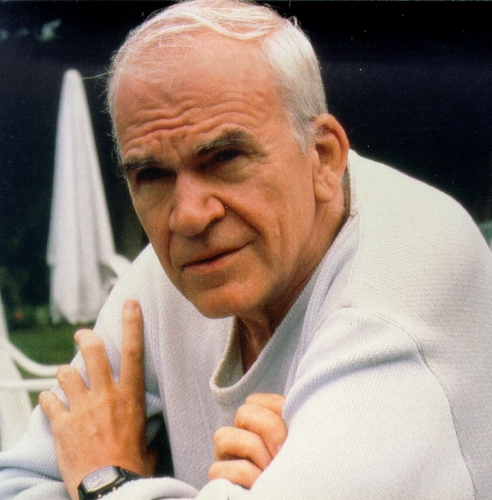Une lecture qui marque à jamais: Les Bienveillantes de Jonathan Littell
Je suis sorti de la lecture des Bienveillantes avec un sentiment d’insondable et froide tristesse qui m’a rappelé le muet effroi que j’ai éprouvé, à vingt ans, en découvrant Auschwitz. Pour la première fois de ma vie, à Auschwitz, m’est apparu quelque chose de réel que je ne pouvais concevoir dans mon irréalité de jeune idéaliste des années 60. Quelque chose d’immense et d’écrasant. Pas du tout les baraquements minables que j’imaginais : d’énormes constructions en dur, de type industriel. L’usine à tuer : voilà ce que j’ai pensé ; et je remarquai que dans la cour de l’usine à tuer désaffectée se débitaient des saucisses chaudes. Surtout : quelque chose d’impalpable, d’invisible et de non moins réel. Quelque chose d’impensable et d’indicible mais de réel.
J’avais vu, déjà, les images terribles de Nuit et brouillard, je savais par les livres ce qui s’était passé en ces lieux, dont je découvrirais plus tard d’autres témoignages, tels ceux du film Shoah. Mais ce que j’ai ressenti de réel à Auschwitz, comme je l’ai ressenti en lisant Les Bienveillantes, tient non pas aux pires visions mais à ce quelque chose d’impalpable et d’indicible, plus quelques pauvres détails : ces tas de cheveux, ces tas de dentiers ou de prothèses, ces tas d’objets personnels. Ces saucisses aussi. Et dans Les Bienveillantes : ce pull-over que le protagoniste a oublié quand il se rend, en Ukraine, sur les lieux d’un massacre de masse où il risque d’avoir un peu froid, pense-t-il soudain…
Or songeant à l’instant à la façon la plus juste d’exprimer le sentiment personnel que laisse en moi la lecture des Bienveillantes, je repense à ces mots notés par mon ami Thierry Vernet dans ses carnets : « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou biens ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi ».

Max Aue est-il jamais né à lui-même ? Un seul épisode amoureux avec sa sœur jumelle Una, à l’adolescence, a cristallisé une passion absolue qu’il tentera vainement de revivre. Sodomisé à l’internat où sa mère et son beau-père, qu’il hait également, l’ont casé pour le punir de son inconduite incestueuse, l’homme jouira par le cul, c’est le mot cru et vrai, sans aimer quiconque, jusqu’à la rencontre d’Hélène, à la toute fin de la guerre, à l’amour de laquelle il ne parviendra pas à répondre après être mort à lui-même sans être né. Sa fantasmagorie infantile culminera dans l’Air d’avant la Gigue finale, où Max se retrouve seul dans la maison vide de sa sœur, en Poméranie, en proie à un délire onaniste autodestructeur.
Il y a de l’impubère ressentimental et du voyeur impatient de vivre toutes les expériences-limites, chez Max Aue, comme chez le Stavroguine des Démons de Dostoïevski. Ce chaos intérieur de l’avorton affectif, fils oedipien d’un grand absent dont on lui révélera les propres crimes de guerre, n’a pas empêché Max Aue d’accomplir de bonnes études de droit (en Allemagne, d’où il est originaire par son père), suivies d’une carrière dans la SS qui le conduit du front de l’Est aux plus hautes sphères de l’Etat, où il finira dans l’entourage immédiat du Reichsführer Himmler et autres Eichmann ou Speer. Vu par ses pairs, Max Aue fait figure d’élément compétent, du genre « intellectuel compliqué », juste un peu froid et rigide, et décidément lent à se marier. Mais rien chez lui du fanatique obtus ou du sadique. Lors des premières « actions » auxquelles il assiste, Max est de ceux qui vivent mal les massacres. S’il y participe, c’est par devoir et soumission à la visée civilisatrice du national-socialisme, au nom du Volk sacro-saint. Pourtant on perçoit à tout moment la fragilité idéologique de cet esthète plus attaché à la philosophie (il lit Tertullien), à la musique (Bach et Couperin) et à la littérature (Stendhal, Blanchot et Flaubert) qu’aux dogmes racistes du régime. Tout au long de la guerre, sa spécialité consiste à rédiger des rapports : sur la loyauté de la France (un premier séjour à Paris le fait rencontrer les collabos Brasillach et Rebatet), la nécessité ou non de liquider les Juifs du Caucase, le moral des troupes dans le « chaudron » de Stalingrad ou l’utilisation des déportés dans la guerre totale. Une scène inoubliable exprime la dualité schizophrénique du personnage : lorsque tel vieux savant juif tchétchène, avec lequel il s’entretient en grec ancien, le conduit sur une colline où un songe lui a révélé l’endroit de sa mort, qu’il tue sans comprendre la parfaite sérénité du saint homme.
 D’aucuns ont reproché à Jonathan Littell le choix de ce narrateur, dont la complexion personnelle risque de « distraire » le lecteur du grand récit des Bienveillantes consacré à l’entreprise de destruction et d’extermination des nazis. Quoi de commun entre le matricide de Max Aue et l’extermination des Juifs d’Europe ? A cette question centrale, Georges Nivat a commencé de répondre dans l’article magistral qu’il a consacré aux Bienveillantes (cf. Le Temps du 11.11.2006), en affirmant que «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l’autre ». Et d’ajouter : «Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg ».
D’aucuns ont reproché à Jonathan Littell le choix de ce narrateur, dont la complexion personnelle risque de « distraire » le lecteur du grand récit des Bienveillantes consacré à l’entreprise de destruction et d’extermination des nazis. Quoi de commun entre le matricide de Max Aue et l’extermination des Juifs d’Europe ? A cette question centrale, Georges Nivat a commencé de répondre dans l’article magistral qu’il a consacré aux Bienveillantes (cf. Le Temps du 11.11.2006), en affirmant que «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l’autre ». Et d’ajouter : «Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg ».
 La lecture des Bienveillantes est une épreuve difficile et décisive, pour moi centrale, réductible à aucune autre lecture contemporaine. On a comparé ce roman à Vie est destin de Vassili Grossman, et sans doute y a-t-il maints rapprochements à faire entre ces deux livres, mais Jonathan Littell, d’une monumentale masse documentaire, a tiré tout autre chose qu’un roman historique « de plus », un témoignage de plus sur la Shoah : au vrai, le cauchemar des Bienveillantes se poursuit tous les jours sous nos yeux dans le monde de l’homme fini qu’on empile et dont on fait n’importe quoi.
La lecture des Bienveillantes est une épreuve difficile et décisive, pour moi centrale, réductible à aucune autre lecture contemporaine. On a comparé ce roman à Vie est destin de Vassili Grossman, et sans doute y a-t-il maints rapprochements à faire entre ces deux livres, mais Jonathan Littell, d’une monumentale masse documentaire, a tiré tout autre chose qu’un roman historique « de plus », un témoignage de plus sur la Shoah : au vrai, le cauchemar des Bienveillantes se poursuit tous les jours sous nos yeux dans le monde de l’homme fini qu’on empile et dont on fait n’importe quoi.
Jonathan Littell. Les Bienveillantes. Gallimard, 903p. Réédité en Poche Folio en décembre 2007. No 4685. 1401p.



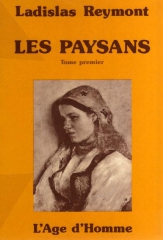
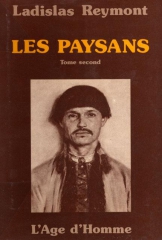 Trois personnages d’une stature romanesque exceptionnelle se distinguent de la communauté. Plus que de grands types littéraires, le vieux Boryna, son fils Antek et la fascinante Jagna Dominikowa représentent les figures élues d’un mythe terrien fondamental. Le temps de leur passion, portée à l’incandescence, ils incarnent le tragique même de la condition paysanne. Maciej Boryna, le père, c’est l’attachement forcené à la terre. Qu’il épouse la jeune et belle Jagna sur un coup de tête, par vanité mais aussi pour faire enrager son fils, lequel lui reproche quotidiennement sa tyrannie de patriarche, n’est en somme qu’un accident de parcours.
Trois personnages d’une stature romanesque exceptionnelle se distinguent de la communauté. Plus que de grands types littéraires, le vieux Boryna, son fils Antek et la fascinante Jagna Dominikowa représentent les figures élues d’un mythe terrien fondamental. Le temps de leur passion, portée à l’incandescence, ils incarnent le tragique même de la condition paysanne. Maciej Boryna, le père, c’est l’attachement forcené à la terre. Qu’il épouse la jeune et belle Jagna sur un coup de tête, par vanité mais aussi pour faire enrager son fils, lequel lui reproche quotidiennement sa tyrannie de patriarche, n’est en somme qu’un accident de parcours.