
Formidable chronique picaresque, Les Masques du héros de Juan Manuel de Prada revisite le premier demi-siècle espagnol avec un humour parodique et une vision de grand artiste.
Ils sont tous là, les héros de la glorieuse bohème espagnole du début du siècle. Entre bistrots et bordels, salles de rédaction et rues investies par le peuple en colère, voici s'annoncer les figures légendaires de la poésie ou du cinéma, du roman d'avant-garde ou de l'activisme anarchiste. Quelques noms suffiront à faire tilt: Lorca, le poète, au milieu de ses camarades de la bohème madrilène. Ou Bunuel, génie de la pellicule en train de monter L'âge d'or sur un coin de bar. Dali jeune lustrant ses moustaches vibratiles, Borges l'esthète apollinien, ou Durruti le farouche conspirateur. Bref, rien que du beau monde.

Et quelle époque romanesque de surcroît: prolétaires glorieux revenant de la campagne du Maroc, anarchistes impatients de balayer tout pouvoir, luttes nobles et légitimes des dominés contre les dominants. Front populaire, guerre civile, fiers ouvriers, méchants fascistes, toute la panoplie d'un feuilleton politiquement correct dont on voit déjà le film qu'il donnerait.
De quoi s'envoler, mais patatras: valsez jobards, car ce n'est pas du tout cette histoire- là que va nous raconter l'impertinent jeune romancier. Retour, par conséquent, à la case départ des Masques du héros, destination la prison d'Ocana où gît un scribouillard obscur, les pieds enchaînés, qui écrit, en 1908, une lettre à l'inspecteur des prisons à qui il demande grâce et qu'il insulte en même temps, le traitant notamment de «vile pédale» dirigeant une «vaillante compagnie de vautours».
D'une tournure ostensiblement «cervantesque», cette extravagante épis- tole, à la fois pathétique et grinçante, fixe d'emblée le portrait de Pedro Luis de Galvez, héros «en creux» du roman qui s'écrira dès le chapitre suivant sous la plume de ce qu'on pourrait dire son ombre, son double funeste, son admirateur et son plagiaire en la personne de Fernando Navales.
Tragicomédie
Pedro Luis de Galvez (1882- 1940) fut une figure singulière de l'art bohème espagnol du premier demi-siècle, qui écrivit un Art de l'arnaque et de magnifiques poèmes reconnus par Borges, dont nous trouvons quelques exemples en ces pages du mélange d'emphase misérabiliste et de pureté cristalline. Fernando Navales, lui, sort de l'imagination du romancier. Autant Galvez paie le prix des «stigmates de l'art», autant Navales se borne à jouir de tout en dilettante. Fils de famille ruinée à Cuba, il crache sur son père en agonie en affirmant que «c'est sur l'expérience de la mort et du sexe que l'homme croît, sur la pourriture d'autrui, comme une moisissure». Conscient qu'il ne sera jamais Galvez, Fernando va cependant chercher à briller dans les cafés de Madrid en récitant des poèmes piqués à Galvez.
En l'absence de celui-ci (qui sème la pagaille révolutionnaire au Chili), Navales connaîtra même la gloire, au théâtre, avec un vil plagiat. Son arrivisme le fera passer ensuite de l'anarchisme au fascisme, avant qu'il ne trahisse les uns et les autres pour mieux retomber sur ses pattes. La seule chose qui sauve cette canaille aux yeux du lecteur est que celui-ci le sait pantin de papier, figure par excellence du vaurien de roman picaresque, et délégué par l'auteur à une narration volontairement grotesque, dans la meilleure tradition de l'outrance tragicomique à l'espagnole, de Quevedo à Goya.
Sarabande de spectres
À chaque fois qu'il parle de l'histoire, Fernando Navales demande «pardon pour la majuscule», et c'est en effet les aspects minuscules de toute destinée qu'il s'attache à rendre en forçant volontiers sur la dérision. Est-ce dire qu'il se cantonne dans l'insignifiance ou dans la mesquine mesquinerie? Tout au contraire: sa mascarade est peuplée de figures supervivantes et hautement pittoresques, qu'il s'agisse de personnages politiques (tels José Canalejas, tombant sous les balles d'un anarchiste, ou le jeune José Antonio Primo de Rivera, passé de la littérature à l'activisme brouillon) ou de gloires artistes.
Au nombre de celles-ci, nous nous bornerons à signaler un Ramon Gomez de la Serna savoureusement restitué, régnant sur sa faune du Café Pombo après avoir veillé toute la nuit dans son donjon de trouvère «né pour être heureux»; le poignant et pantelant jeune poète maudit Armando Buscarini, ami à la vie à la mort de Galvez, se traînant de nids de poux en lits de filles, et que le narrateur fait jeter au cabanon; Jorge Luis Borges que ses camarades cornaquent de force (et en vain) au bordel; ou encore Luis Bunuel inséminant la moitié des harems hollywoodiens après avoir «cassé du pédé» à la sortie des cafés madrilènes.
Cela dit, les vrais protagonistes du roman ne sont pas ceux dont les noms sont «restés», mais chaque figure grimaçante ou torturée de cette frénétique sarabande de spectres, laquelle culmine au moment de l'invasion de Madrid par les fous libérés de l'asile, armés de pistolets et enfin aptes appliquer la consigne d'André Breton de «tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule»...
Sombre grandeur
S'il marque une complaisance éventuelle dans le sordide (mais il nous dira que c'est le propre du genre, ou que c'est Fernando qui tient la plume...) Juan Manuel de Prada en impose plutôt, en définitive, par un humour qui sonde bien plus profond que la moquerie ou que la gouaille cynique de Fernando. C'est en effet un sentiment paradoxal de fraternité et de sombre grandeur qui se dégage de cette chronique romanesque irrévérencieuse en diable, où les emblèmes figés de l'avant-garde et de la révolution, de l'art ou de l'histoire, se lézardent sous les coups de boutoirs de l'aveugle nécessité et de la tragédie collective.
Tout est farce apparente dans Les masques du héros, mais les masques y prennent, comme si tous les vices rendaient hommage à la vertu d'écrire, une consistance infiniment humaine.
Juan Manuel de Prada: Les masques du héros. Traduit de l' espagnol par Gabriel laculli. Editions du Seuil, 585 pp.
Nota bene : Né en 1970 Baracaldo, en Biscaye, Juan Manuel de Prada est entré en littérature avec Conos, son premier roman, et Le silence du patineur, un recueil de nouvelles. La tempête, son deuxième roman, été couronné en 1997 par le Prix Planeta. Sous les traits d'un jeune homme bien peigné, Juan Manuel de Prada se révèle le plus échevelé des romanciers, qui pourrait partager le credo de son protagoniste: «L'écrivain de race se distingue du dilettante par son instinct d'assassin...»

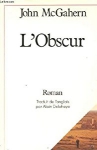 Pour qui ne sait rien encore de John McGahern, né Dublin en 1934, la meilleure introduction à son œuvre nous semble cependant L'Obscur, interdit à sa parution (en 1965) et qui valut au jeune auteur d'être licencié de son poste d'instituteur. Rien pourtant, à nos yeux, de scandaleux dans ce récit de la pénible émancipation d'un jeune fils de paysan pauvre, qui «fuit» la terrible dureté de son père (lui-même écrasé par sa condition et son veuvage) dans l'étude et parvient à décrocher la bourse synonyme d'une liberté dont il ne saura à vrai dire que faire.
Pour qui ne sait rien encore de John McGahern, né Dublin en 1934, la meilleure introduction à son œuvre nous semble cependant L'Obscur, interdit à sa parution (en 1965) et qui valut au jeune auteur d'être licencié de son poste d'instituteur. Rien pourtant, à nos yeux, de scandaleux dans ce récit de la pénible émancipation d'un jeune fils de paysan pauvre, qui «fuit» la terrible dureté de son père (lui-même écrasé par sa condition et son veuvage) dans l'étude et parvient à décrocher la bourse synonyme d'une liberté dont il ne saura à vrai dire que faire. 









